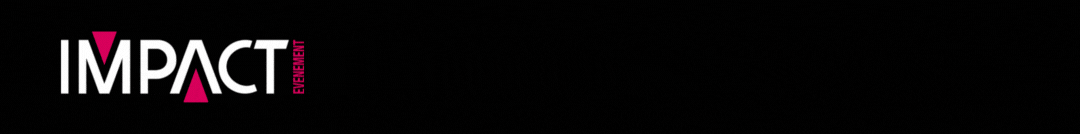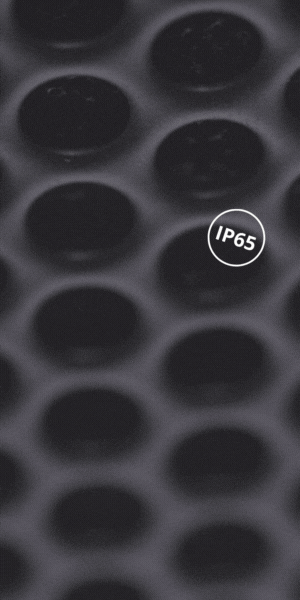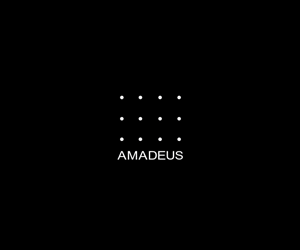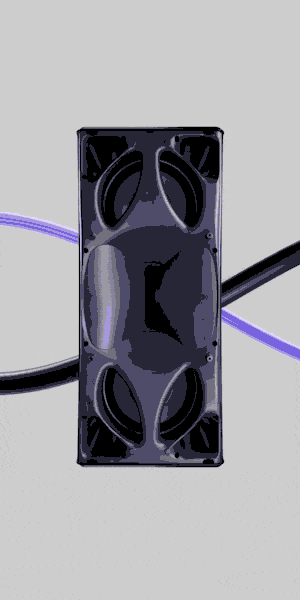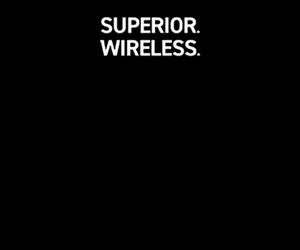Le système Line Array ANYA de EAW a vu sa (longue) phase développement s’achever en 2012 et ses premières apparitions d’essai en situation début 2013. Mais cette année Anya fait réellement ses débuts et était présent à Prolight + Sound avec même une séance d’écoute et de présentation organisée dans une salle de concert proche (à Offenbach).
 Bluffant à plus d’un titre, Anya est l’aboutissement et la réunion de technologies développées pour d’autres séries EAW avec un contrôle et une mise en place entièrement automatiques.
Bluffant à plus d’un titre, Anya est l’aboutissement et la réunion de technologies développées pour d’autres séries EAW avec un contrôle et une mise en place entièrement automatiques.
De prime abord cela ressemble plus à un concept, comme les concept cars en automobile, mais un concept opérationnel et déjà utilisé depuis le début de l’année avec des retours prometteurs. Ne cherchez pas de réglage d’angulation sur les enceintes, il n’y en a pas. Les lignes se montent droites, les réglages de directivité verticale et de tilt s’effectuent par DSP et le système s’auto-configure.
La forme, en ailes de papillon (cela rappelle un système transalpin) permet de juxtaposer des lignes verticales pour couvrir de 70° en horizontal (l’ouverture nominale horizontale) jusqu’à, pourquoi pas, 360°, en réalisant un cylindre rayonnant, par multiple de 70°.
Cela permet également d’exploiter l’ensemble du devant de l’enceinte comme un pavillon à profil curviligne et de ménager pour le bas du spectre des ouies sur les cotés arrondis (Offset Aperture Loading) et ainsi de mieux contrôler l’ouverture horizontale dans le bas du spectre.


Mais pour que cela fonctionne en toute cohérence, il y a, comme on s’en doute, beaucoup de monde à bord (et du beau). Système actif trois voies embarquant pas moins de 22 transducteurs et 22 canaux d’amplification classe D précédés de 22 canaux DSP, une boîte Anya peut délivrer un niveau moyen (faisceau non conformé) en demi-espace de 131 dB (137 dB peak) dans le grave, 136 dB (142) dans le médium et 140 dB (146) dans l’aigu.


Entièrement symétrique par rapport au plan vertical du guide d’aigu, une enceinte embarque deux 15’’ longue excursion à moteur Néodyme et bobine 4’’ (24 mm d’excursion en régime linéaire) avec une charge acoustique en deux parties (offset Aperture loading), 6 transducteurs médium à cône 5’’ (bobine 38 mm) et à moteur Néodyme surdimensionné montés en 2 x 3 sur le pavillon.

Chacun reçoit une pièce de mise en phase radiale et le système CSA (Concentric Summation Array), constitué de multiples ouvertures (agissant comme autant de sources ponctuelles) réalisées dans le pavillon, autorise une fusion optimale avec le « ruban » rayonnant d’aigu sans interactions.
La partie centrale d’aigu et son guide, qui évidemment couvre toute la hauteur d’une boîte, comporte 14 tweeters à compression à gorge 1’’ dont les centres acoustiques sont espacés d’un pouce sur le guide qui épouse le profil du pavillon CSA.
Le fait d’utiliser beaucoup de sources 1’’ plutôt que moins de sources plus importantes permet d’éviter les modes de rupture des diaphragmes et de mieux restituer les aigus sans coloration ; de plus cela « simplifie » la géométrie du guide (breveté comme le CSA).
L’électronique embarquée comprend une alimentation universelle (à découpage), 22 canaux d’amplification classe D (modifiée – ?- selon le constructeur) dont 2 x 1700 W crête pour les woofers, et 22 canaux de traitement DSP pour modifier la réponse et le retard de chacun des éléments selon la conformation de faisceau choisie via le logiciel Resolution 2 d’EAW qui contrôle tous les paramètres d’une ligne complète. Bien entendu, les DSP se charge également des protections.
La sophistication du système ne s’arrête pas là puisque chaque boîte reçoit quatre transmetteurs IR qui donnent la position de chaque boîte (avec son identification) au sein d’une ligne sans s’en préoccuper à l’assemblage, et qu’il y a un dispositif d’autotest, fonctionnant à partir d’une batterie interne, qui garantit le fonctionnement correcte d’une boîte avant sa mise en place. Un micro interne permet d’enregistrer (en mémoire interne) la fonction de transfert de chaque transducteur d’une boîte au départ de l’usine et de faire ensuite des comparaisons.
Avec Resolution 2, Smaart et un micro de mesure, le système peut être calé en un clin d’oeil pour s’adapter à tous les types d’audience à l’aide des générateurs internes (de bruit et de bursts).

Anya utilise le réseau Dante pour le transport des informations de contrôle et de l’audio mais chaque boîte est équipée également d’une entrée symétrique analogique XLR (avec renvoi) et d’une entrée AES/EBU.
Le système d’accroche, très simple avec les manettes de verrouillage/déverrouillage situées sur les côtés de chaque boîte, autorise la constitution de lignes de 18 modules (130 kg chaque) avec un facteur de sécurité de 10 :1. Le plateau de transport, conçu pour supporter 4 modules pré-montés, accepte jusqu’à 16 boîtes, ce qui permet de monter très facilement des lignes adjacentes avant de les accrocher.
On l’aura compris, ce système intelligent est conçu pour faciliter la vie des utilisateurs tout en délivrant le bon son aux bons endroits mais cela a un prix, qui avoisinerait 900 K€ (prix public) pour un kit de 24 modules, l’ensemble des cordons et de la distribution électrique ainsi qu’un kit de maintenance.