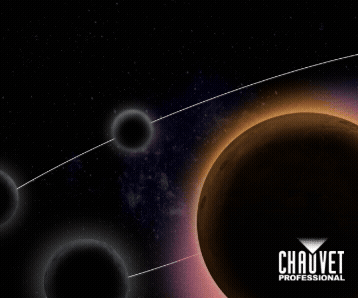Enfin le voilà !
Le tant attendu Martin Viper XIP, le renouveau à LED du succès planétaire “Viper” encore présent dans les parcs un peu partout, tant cette machine est fiable et durable. Son héritier, complètement dans l’air du temps, promet de le remplacer avec non moins de succès.
Nous avons attendu qu’il soit dans sa version définitive pour l’ausculter dans le studio Hocco à Vitry-sur-Seine. Et nous ne sommes pas déçus !
L’appareil est esthétiquement splendide. Son design avec sa physionomie “Mac Viper” reconnaissable entre mille. Ses formes particulières et ses poignées en bout de bras l’affirment d’emblée comme « de la famille » ! Et pourtant, il est plus racé, plus actuel.