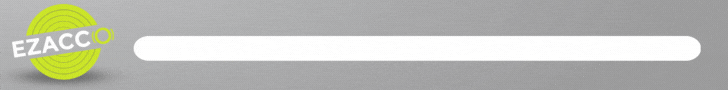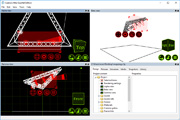Tout a commencé par un mail de Maxime Ménélec qui disait précisément ceci : « Je suis au Zénith de Paris le 9 avril avec Steph et je voudrais te faire écouter quelques truks ».
Dictaphone OK, appareil photo OK, oreilles OK, nous voici partis à la rencontre de toute l’équipe de la tournée Top50 de passage dans la capitale où Max officie au système et fait des expériences, non pardon, des truks !

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Maxime Ménélec a commencé en assistant Stéphane Plisson, époque MiniMax, puis il a pris en main le système de Steph, perdant au passage le Mini.
Depuis quelques mois et après avoir bien potassé des bouquins avec beaucoup d’images mais pas de jolies filles dedans, il est devenu KSE (K System Engineer) pour L-Acoustics, autant dire qu’il est reconnu comme étant un bon, surtout vu son âge.
Un coup d’œil dans la salle suffit à comprendre que ce ne sont pas les K1 en principal, ou les K2 en rappel latéral et downfill qui constituent la nouveauté à écouter. Pas non plus de KS28 ou de LA12X qui viennent d’être dévoilés à Francfort. La surprise de Max tient dans l’accroche et le calage du K2 dans le K1. Tout simplement. Simplement ? Pas tant que ça.
Après une poignée de main à Frédéric Bailly, ingénieur application Touring L-Acoustics; présent lui aussi dans la salle, on laisse Max s’expliquer.

Maxime Ménélec : “L’idée est d’avoir le minimum de recouvrement, juste une zone de raccord entre le K1 en principal et le K2 en rappel latéral. Ce dernier est déployé en ouverture horizontale 70°.
Ce montage très proche entre les deux lignes rend le grave le plus constructif possible. Quand on éloigne l’“outfill” du système principal, on créé des interférences dans le grave.
SLU : Qui a eu cette idée ?
Maxime Ménélec : L’idée vient d’une discussion avec Fred Bailly. Il y a deux ans lorsque nous sommes partis pour “Danse avec les Stars” avec Alex Ly, on a accroché la diff en K2 à l’avant du carré de danse, de sorte à bien couvrir le haut des gradins tout en plaçant du Kara pour arroser la fosse.
Ayant le choix de positionner les “outfills”, on a fait des tests avec deux lignes de 10 boîtes. On a commencé à placer les latéraux derrière le “main” de sorte à avoir le point arrière de l’“outfill” aligné avec les deux points du “main” et on a testé en découvrant qu’on était hyper constructif partout.

A la régie on n’a que 2 millisecondes de variation avec tout le système. Il n’y a que la petite zone d’overlap qui peut sous certaines conditions poser problème, si ce n’est qu’on ne l’entend pratiquement pas. Les systèmes actuels sont aujourd’hui très bien conçus en directivité et si tu penses bien ta ligne, normalement c’est presque gagné.
SLU : C’est exact, ça passe très bien. Du coup le délai entre K1 et K2 est de combien ?
Maxime Ménélec : 2 milli, et c’est le “main” qui est délayé sur l’“outfill” et non l’inverse, ce qui permet en plus de ne pas avoir de source virtuelle qui se crée en permanence. Dans une configuration habituelle où tu as délayé ton “outfill” placé à 5 ou 6 mètres de ton “main”, quand tu es en régie, c’est l’effet inverse qui se produit et tu créés encore plus de points d’interférence.
Avec des latéraux constitués de petites boîtes comme le Kara, ce n’est pas trop problématique car même avec 9 boîtes, on n’atteint qu’un petit contour, mais quand les “outfills” sont constitués de K2 et que t’en alignes 12, 16 mais même moins, le contour va générer beaucoup d’interférences dans la salle. Rien que ce soir, avec 6 K2, j’atteins déjà 8 dB, d’où l’idée de placer les “outfills” derrière et très près du “main”.

SLU : Vis-à-vis de la scène tu es placé comment ?
Maxime Ménélec : Le “main” est avancé à trois mètres, le point avant des K2 est à deux mètres et le point arrière à 40 cm de la scène.
SLU : Ce type de montage peut être déployé partout et pour tout type de prestation ? Il génère un poids moins réparti et une gêne visuelle un peu plus importante.
[private]
Maxime Ménélec : Il y a toujours des situations où le poids et des aspects visuels priment mais pour des Zéniths où l’on dispose de capacités d’accroche importantes et où le son a son importance, ça devrait aller. Si tu as un bon rigger, ce n’est pas une purge au montage. Ce soir avec 10 K1 et 2 K2 en “down” plus les 6 K2 d’“out”, nous avons une charge totale de 1,2 T pour le “main” et 400 kg pour les K2, rien d’insurmontable pour des salles conçues pour ça.
SLU : Est-ce que selon toi ce type de montage est réalisable avec toute sorte de boîte ?
Maxime Ménélec : Nous avons la chance d’avoir du K2 qui offre plusieurs directivités symétriques comme asymétriques et dispose d’un très bon guidage qui permet de réaliser un “overlap” minime entre le “main” et l’“outfill”. Employer du Kara qui ouvre à 110° de façon fixe génère un peu plus d’interférences dans le médium et l’aigu car le recouvrement est forcément plus grand. Comme le délai ne peut être qu’un seul, il est essentiel de limiter cet “overlap” pour minimiser les interférences audibles.




SLU : Tu as placé ta boîte basse de l’“outfill” à hauteur de la dernière K2 “down”, c’est voulu ?
Maxime Ménélec : On pourrait très bien remonter l’“outfill” et le tilter vers le bas. L’idée ce soir c’est d’avoir la même couleur entre les K2 qui finissent la ligne de K1 et les K2 des “outfills”. Les boîtes du bas tapent à la même distance du gradin, d’où ce choix de les avoir à la même hauteur. La position de l’“outfill” et sa hauteur ne sont pas neutres dans le rendu du grave du système principal. C’est un peu comme lorsque tu places des K-Sub derrière ton système. Suivant l’endroit où tu les places, tu fais varier la directivité de ton grave. Vlad ou Bellote ont déjà placé du K1-Sub en bas de ligne sous le K1 pour changer la directivité du système.

SLU : Dans la transition K1 vers K2 en tournant dans les gradins, on constate une différence de couleur logique dans le haut entre les deux boîtes mais aussi dans le bas.
Maxime Ménélec : C’est logique. Le K1 a un 15 pouces la où le K2 a un 12 pouces. Le rendu et la profondeur ne sont pas tout à fait les mêmes et puis les dix K1 ont un contour de 18 dB là où les six K2 n’en offrent que 8. Pas mal de l’énergie dans le bas du spectre vient du K1.
K2, l’arme de sonorisation massive
SLU : Revenons à l’enceinte idéale pour ton montage. Faut-il un modèle qui guide très bien le son et, dans ce cas, K2 est-il la solution ?

Maxime Ménélec : Ce qui est bluffant avec ce modèle c’est la cohérence que tu as entre les boîtes déjà dans la ligne, dans le médium-aigu et surtout dans l’aigu.
Quand tu ouvres les angles, l’aigu reste très bon, très naturel et cette qualité est propre au K2, on ne la retrouve pas forcément dans d’autres modèles. C’est un aigu qui monte très haut et qui est doux, mais qu’il faut bien entendu travailler comme dans toutes les boîtes du marché. Cette enceinte est réussie aussi par sa cohérence. Du grave à l’extrême aigu, tout se tient. Si tu as une bonne balance tonale, ça roule.
SLU : Commet fais-tu à donner des couleurs dans le bas à tes “outfills” quand ces derniers sont par exemple constitués de Kara ? Le contour que tu tires d’HP en 8’’ ne suffira jamais face aux autres références du catalogue L-Acoustics.
Maxime Ménélec : Il y a deux éléments clé du LA-Manager dont je me sers exclusivement, je n’emploie aucun autre processeur de son externe. Il s’agit du Zoom Factor et du LF Contour, plus les 8 points d’EQ. Cela marche très bien et c’est largement suffisant pour travailler car en dehors des modes de salle et d’un lissage de sa courbe, le système marche très bien ainsi. J’essaie toujours d’aller dans le sens préconisé par le constructeur du système, que je travaille avec du L-Acoustics, de l’Adamson, du d&b ou autre.

SLU : Revenons au K2 et à sa polaire. Elle est fatalement plus régulière que celle du K1, ces deux boites sont séparées par une dizaine d’années…
Maxime Ménélec : La polaire du K2 est monstrueuse. Elle a bénéficié à plein du travail fait sur K1 mais avec des outils plus modernes ce qui rend l’ouverture encore plus régulière et constante.

SLU : Est-ce que ton montage ne bénéficierait pas d’être bâti exclusivement sur K2 ?
Maxime Ménélec : Si à plein, c’est le meilleur résultat qu’on ait eu. K2 en “main” et en “outfill” ça marche du tonnerre et la balance tonale est naturellement identique puisque ce sont les mêmes HP.
Tu peux aussi par exemple choisir 70° en “main” et 90° en extérieur et tu peux jouer, autant sur la directivité horizontale, que verticale.
Tu peux aussi rediriger le lobe du grave de tout le système en jouant avec l’“outfill” dans la ligne pour le remonter ou le redescendre puisque tu es constructif partout dans le grave.
Si par exemple tu as un manque d’énergie dans une grande salle, tu remontes un peu l’“outfill” et ça va te redonner du contour en façade sans être interférent.

Pour résumer, l’“outfill” n’est plus une contrainte puisque tu as quelque chose qui est parfaitement constructif, mais il faut travailler et bien caler l’ensemble surtout quand tu as des gros “outfills” avec beaucoup de contour. J’aurais aimé avoir du K2 aussi en principal pour ce soir mais il est victime de son succès, du coup il est dur à trouver.
SLU : Comment as-tu déterminé avec précision que ton montage ouvert à 55° entre “main” et “outfill” passe et tient mécaniquement dans une salle ?
Maxime Ménélec : Soundvision est très précis, mais pour être sûr et certain de mon coup, je contrôle tout dans Autocad. Je ne le fais pas pour chaque date, mais pour le Zénith de ce soir, j’ai préféré le faire. Malgré tout, on a dû légèrement ajuster car les deux boîtes du bas sont à 5 cm. Mais ça passe (rires)
SLU : Ton résultat de qualité sur les extérieurs ne pourrait-il pas te permettre un tilt intérieur du système ce qui limiterait le nombre d’enceintes de complément pour boucher les « trous » ?
Maxime Ménélec : Je ne suis pas trop pour tilter vers l’intérieur. Je préfère que le système soit bien droit. Même si les polaires sont bien faites aujourd’hui, au centre et donc à la console, cela compliquerait le calage du médium et de l’aigu et le rendu ne serait pas pareil et uniforme.”
Au plateau avec Axel Vivini
Quoi faire quand on est accueilli par les techniciens d’une tournée et qu’on meurt d’envie de les faire parler…On le fait ! Après Max, place à Axel Vivini qui assure les retours du groupe qui accompagne l’ensemble des artistes de la tournée, bien sûr de ces derniers ainsi que MC Toesca et sa légendaire patate. En plus, sur le plateau des X15HiQ brillent de mille feux, l’occasion de demander un avis éclairé sur ce nouveau retour.

SLU : Comment trouves-tu les X15 et leur rendu ?
Axel Vivini : “J’en ai parlé à Fred (Bailly NDR). Selon moi dans le grave comme dans l’aigu, on a trop de choses dont on n’a pas forcément besoin quand on mixe des retours. J’aimerais avoir un preset axé sur les retours qui réduise les informations pour les concentrer là où on en a vraiment besoin en wedge.
La X15 est une enceinte conçue pour être polyvalente, et c’est tout à fait le cas, mais en retours on n’a pas besoin d’avoir un aigu qui monte aussi haut avec autant d’énergie dans l’extrême aigu et c’est un peu pareil dans le grave. Il faut le raccourcir un peu pour se concentrer plus sur l’impact.
Ceci étant dit, c’est un bon et un vrai wedge avec une qualité importante qui est celle d’avoir la même balance tonale quel que soit le niveau auquel tu travailles, une balance naturelle et agréable. Tu prends ce wedge, tu fais trois points d’eq et c’est parti, la voix sort tout de suite. Ils ont oublié les Speakon sur les côtés mais ça mis à part, l’ébénisterie est top.
SLU : En fait tu aimerais avoir dès le départ un rendu plus ramassé…
Axel Vivini : Oui parce que tailler dedans enlève de la dynamique.
SLU : Quel preset utilises-tu, celui de base ou bien la version à basse latence ?
Axel Vivini : Celui de base. Il retarde un peu plus mais je le préfère car on n’est pas sur un point de chant lead mais bien sur une ligne de wedges où le son doit être uniforme et je trouve qu’il est mieux dans ce rôle.

SLU : Comment trouves-tu la couverture du X15 ?
Axel Vivini : Il est hyper homogène et en plus le son sort vraiment de la boîte.
Pour revenir sur sa générosité dans les extrêmes, quand par exemple on utilise les wedges en ligne avant, entre les sides, ce sont ces derniers qui apportent le complément dont on a besoin dans l’aigu, le grave, l’ouverture et l’image. Dans les wedges je n’ai besoin que de précision et de projection.
Il est possible que prochainement L-Acoustics apporte des solutions soit dans le preset, soit dans les outils de contour. Quoi qu’il en soit, je suis heureux car c’est un bon outil de travail et comme on va le retrouver chez tous les prestataires, autant qu’il soit réussi, ce qui est le cas. J’ai 8 statiques devant, très peu de corrections et aucun problème.

SLU : Tu répartis comment entre wedges et sides ?
Axel Vivini : En bas je mets une voix assez brute, du pied et un peu de basse, les sources plutôt mono et dans les sides tout le reste pour élargir le plus possible l’image.
Les musiciens sont tous en ears avec les amplis AMP912 d’Earsonics. Comme ils ne bougent pas et qu’en HF on a de plus en plus de contraintes, autant les mettre en filaire, sachant qu’en plus ça sonne et que cet ampli est, à mon avis, ce que l’on trouve de mieux.
SLU : A quoi te sert le X32 Behringer ?
Axel Vivini : à gérer tous les talks. La première raison est que cela permet de décharger la console principale.
La seconde est que si j’ai un problème avec la console, je ne perds pas les talks. Si je dois rebooter ou si Steph doit le faire, le réseau d’ordre reste toujours actif et on peut continuer à communiquer.

SLU : En plus ça sort bien là-haut tes talks !
Axel Vivini : Ah je te remercie, au moins j’ai réussi ça (rires) !
Sans oublier que le rapport qualité/prix de cette table est imbattable.
En rack elle coûte dans les 1300 € TTC et sort d’origine en AES50 ce qui est très pratique si tu es en Midas ou bien en MADI via une carte optionnelle pour s’interfacer avec d’autres consoles. Je la pilote avec mon écran sous les yeux.
Earsonics bien représenté
SLU : Tu utilises des Velvet de Earsonics en universel à ce que je vois…
Axel Vivini : Oui, ce sont de bons casques. J’en ai 14 paires et ça marche très, très bien. C’est assez proche de l’EM32 même si ça reste un universel avec toutes les contraintes propres à cette technologie et encore plus ici puisqu’on ne peut pas mouler des adaptateurs, la canule est plus grande que sur les autres universels. Ce casque a pas mal de headroom, et même pour les chanteurs qui écoutent fort, on peut garder un signal équilibré, et c’est une vertu très rare.
SLU : Tu fais comment pour juger de la pertinence d’une demande ? Tu écoutes ne serait-ce que quelques secondes au niveau de chaque artistes ?
Axel Vivini : Oui bien sûr, mais tout comme Ben Rico, on règle une fois pour toutes un volume fixe sur les packs et autres amplis, et c’est nous depuis les régies qui déterminons le niveau, ce qui nous permet, en AFL, d’écouter exactement ce qu’ils entendent. Après, je n’écoute pas tout le temps à leur niveau…
SLU : Faut préserver l’outil (rires)
Axel Vivini : Exactement ! Je ne peux pas le casser. De là l’avantage d’avoir des casques qui ont une balance tonale régulière à tous les niveaux.
SLU : La régie retours est mise à disposition par WIP ?
Axel Vivini : Oui absolument, la boîte de Laurent Midas.”

Et Steph il ne parle pas ?
Bien sûr il a parlé, mais pour mettre en avant ses collaborateurs, son équipe, celles et ceux qui travaillent avec lui et font de chaque date une réussite pour le public comme pour les artistes.
Appelons ça l’esprit « MaWip » car il sait à quel point le matériel c’est bien, mais l’humain passe avant, même quand il fait des blagues de potache ! Surtout quand il les fait d’ailleurs, pas vrai Max !
Conclusion
Il ne fait aucun doute que le montage serré des “side hangs”, les latéraux en bon français, marche sacrément bien et pas uniquement sur des graphiques qui en démontrent la justesse théorique. On a beau se balader de long en large, le grave est omniprésent et on coulisse avec une absolue fluidité du K1 au K2.
Certes, tout n’était pas parfait et quelques K2 en plus pour avoir un contour plus flatteur vis-à-vis des K1, et une ligne plus droite pour retrouver le haut si naturel du K2 n’auraient pas été de refus, mais une fois qu’on a dit cela, il paraît difficile aujourd’hui d’accrocher des renforts latéraux autrement que comme ça, surtout si ces derniers sont de taille respectable et donc en mesure de creuser le grave façon gruyère.
Outre le bas du spectre, le médium et l’aigu passent aussi comme une fleur, à en croire que c’est facile de raccorder deux lignes. Juste le rendu d’ensemble et les voix nous ont paru lors des premiers titres un poil trop forts et rêches, après, est-ce que le K1, une bête taillée pour les grands espaces et conçue pour avaler les distances, est le choix idéal dans une salle somme toute petite, à vous de trancher !
Un dernier mot pour les lights, ça devient une habitude, mais quand il s’agit de distribuer les bons points, ce n’est pas la plus mauvaise. Efficaces, justes, colorés et avec quelques jolies trouvailles, ils ont apporté du rythme et du liant au show, un peu comme le fait Marc Toesca chaque soir. Bravo Aldo.

[/private]