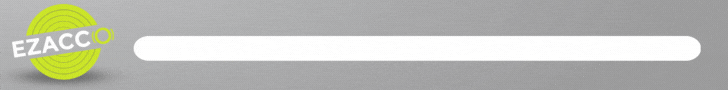Une fois encore, c’est par le biais de comiques que nous avons la chance de découvrir une jolie configuration audio, aussi simple à mettre en œuvre qu’efficace, qualitative et sécure à l’emploi. Nous la devons à Matthieu Speck qui, pour l’occasion, délaisse les retours et prend la route en compagnie de Chevallier, Laspalès et Dante. Mais c’est qui celui-là !

C’est à Paris à l’Espace Cardin que nous retrouvons Matthieu pour les quelques dates parisiennes d’une tournée débutée en septembre 2015. Les confortables velours rouges d’une salle dont la pérennité semble faire débat nous accueillent pour un rapide point avec lui avant de plonger dans le dur.

SLU : Matthieu, comment es-tu rentré dans l’équipe de Chevallier et Laspalès toi qui as un âge tendre et une tête d’ado ?
Matthieu Speck : 34 ans (rires) ! J’ai accueilli la tournée l’année passée à Roanne en tant que prestataire. On a beaucoup discuté avec l’ingé son qui assurait cette tournée. Il m’a rappelé deux mois après pour le remplacer sur les dernières dates.
SLU : Exit Age tendre…
Matthieu Speck : Fatalement, la prod a été liquidée*. En octobre j’ai recommencé à travailler pour Magscène et d’autres artistes ce qui m’a fait le plus grand bien car le fait d’être étiqueté Age tendre t’éloigne des décideurs. J’ai recroisé du monde, je suis retourné dans des petites salles en pleine ville et ça aussi c’est agréable.
Une grosse tournée rime souvent avec périphérie. T’arrives le matin il fait noir et repars… Il fait toujours noir.
SLU : Et on te contacte pour te proposer de bosser avec tes premiers comiques…
Matthieu Speck : C’est ça. La bonne surprise. Une quarantaine de dates jusqu’à janvier 2016.

SLU : Quand tu as remplacé l’ingé précédent, tu employais le matériel qu’il avait prévu ?
Matthieu Speck : Tout à fait, alors que là j’ai pu concevoir mon système d’autant que la jauge des salles était beaucoup plus grande que lors des premières dates où j’ai tenu la console.
En revanche il m’a parfaitement formé aux besoins de Philippe et Régis et j’ai pu apprendre le spectacle.

SLU : Quel prestataire fournit le matériel ?
Matthieu Speck : C’est Dushow pour le son et l’éclairage. Je voudrais à ce propos remercier Aymeric Sorriaux pour son aide. Nous avons une organisation de petite tournée même si ce n’est pas vraiment le cas. On se déplace en voiture à trois avec l’éclairagiste et le régisseur, et dans le camion il y a mon son, à savoir le rack de scène avec les HF et les retours, et la régie façade.
Pour l’éclairage, il y a les automatiques et enfin nous transportons le décor. La diffusion est soit celle de la salle, soit celle que nous faisons installer pour nous par des prestataires locaux. Nous voyageons léger. Les Kiva que tu vois ici à Cardin ont été accrochées à notre demande.
SLU : Quand tu utilises la diffusion de la salle c’est un peu la loterie…
Matthieu Speck : En quelque sorte, mais j’aime ça car tous les jours c’est différent, tu croises plein de personnes, tu discutes beaucoup, tu entends d’autres choses et cela te garde éveillé. Tu arrives le matin et, tiens, c’est du d&b… Je suis souvent aux retours, et l’été je travaille sur des façades, du coup je fais plein de découvertes.
Au cours de cette tournée j’ai par exemple bien aimé le V8 d&b que j’ai eu dans le Zénith de Dijon et au MusiKHall de Rennes, il a une super couleur, en plus petit, le Metrix d’Adamson qui a un son d’enfer et enfin le Kara d’L-Acoustics que je connais par ailleurs très bien, une valeur sûre.
Précision Vs Pression
[private]

SLU : Tu as davantage besoin de précision que de pression…
Matthieu Speck : Bien sûr. Les voix seules sont plus dures à reproduire que la musique. Le moindre défaut s’entend tout de suite.
SLU : Quand tu as été chargé de concevoir ton système de mixage de tournée, t’es-tu approché des spécialistes de l’Est (rires) !
Matthieu Speck : Non, j’ai profité de la fin de la première partie de la tournée avant l’été pour bien apprendre. Ma vraie crainte était ma mémoire, la gestion du show, les tops, les séquences à envoyer, la conduite tres compliquée…

SLU : Aux retours aussi tu dois gérer des moments clé.
Matthieu Speck : Oui mais j’avais peur de rater des ouvertures ou des fermetures. En fait, au bout du troisième show j’avais tout en tête et maintenant je me détache de la conduite et c’est quasi automatique. Je sais, c’est bête, mais il vaut mieux douter de soi, c’est plus sûr !
Pour en revenir à ce que j’ai appris et gardé, il y a le DPA4060. Il n’était pas question d’en changer. Il marche très bien en cravate et les artistes l’apprécient et ça fait quelques années qu’ils l’ont adopté.
Ils ont tellement l’habitude que ce sont eux qui le placent sur leur chemise et le régisseur ne fait que vérifier par acquis de conscience.
Moi-même je suis le rendu sonore et je demande parfois un léger ajustement en cours de show mais c’est rare et pas évident, les sketchs s’enchaînent très vite.
L’éloge de la polyvalence

SLU : Avant que tu nous parles de ta configuration dans le détail, revenons quelques minutes sur ta carrière. Tu viens des retours. Comment cela se fait-il que tu prennes en charge des systèmes l’été ?
Matthieu Speck : Déjà les tournées s’arrêtent donc il faut trouver autre chose à faire, et puis j’aime beaucoup ça. J’ai beaucoup travaillé avec Magscène, moins maintenant, et désormais je suis pas mal appelé par Dushow. Cela fait trois ans que je travaille aux Eurockéennes avec Christophe Dupin. Quand j’ai arrêté Age Tendre, j’ai tout de suite été avec Arnaud Bonhomme qui a tenu la façade les 3 dernières années, effectuer le stage K1 chez L-Acoustics.
J’aime bien les deux aspects du métier : monter des enceintes pour le côté physique et caler le tout. Je me sers de Live Capture, qui fait partie d’une suite dont le nom commun est Wave Capture.
SLU : Comment as-tu connu ce soft ? On est plus habitué à d’autres références…
Matthieu Speck : C’est par le biais de Christophe Dupin qui nous l’a sorti à Belfort dès ma première année avec lui et depuis je ne le quitte plus.
SLU : Et les retours avec tout ça…
Matthieu Speck : Je continue ! Depuis début 2015 je tourne avec Chico et les Gipsy aux retours. Ils tournent en permanence sans même d’actualité musicale. Leur musique s’écoute dans le monde entier ce qui fait que la moitié des dates a lieu en France et l’autre moitié à l’étranger plus les soirées privées. C’est gros, on est 19 en tout en comptant les musiciens !

SLU : Une fois que la tournée de Chevallier et Laspalès sera finie, quelle sera ton actualité ?
Matthieu Speck : J’ai quelques projets qui ne sont pas encore finalisés mais surtout je vais tourner avec Chico en double équipe. Nous sommes 4 entre face et retours et nous alternons, ce qui nous laisse toute latitude pour accepter d’autres prods. On voyage léger, je prends la console qu’on me donne sur chaque date. Imagine aussi la difficulté d’avoir 22 wedges dans chaque salle (rires) ! C’est le défi d’en avoir le plus possible qui se ressemblent mais c’est ça qui rend notre métier si passionnant. Je me suis par exemple retrouvé avec une Pro2 Midas en Hongrie : une belle surprise. Je fais en sorte d’être le plus polyvalent possible : j’accueille, je cale des systèmes et mixe face et retours. J’étais au plateau pour la 500e de Taratata.
SLU : Et les gros plans comme Age tendre ne te manquent pas ?
Matthieu Speck : Bin si, un peu et de plus en plus. Les grosses machineries musicales me plaisent d’autant que j’ai baigné dedans très tôt. J’espère pouvoir alterner entre toute sorte de spectacles, du comique à la très grosse tournée, et toujours en tant qu’intermittent. Je ne suis pas intéressé par d’autres statuts.
SLU : Tu n’as pas envie de te stabiliser un peu ?
Matthieu Speck : Non, pas encore. Je suis marié, j’ai deux enfants et j’ai une maison à Lyon et pourtant je veux encore bouger. J’arrive à bien concilier les deux et quand je passe le seuil de la maison, fatigue ou pas, je remets le compteur à zéro.
Le Dante écrase la concurrence
Le temps passe et nous n’avons pas encore parlé de l’infrastructure technique pensée et mise sur pied par Matthieu. Sébastien Jallot, spécialiste de réseau et d’informatique en général est à la baguette.
SLU : Le cœur du système est donc un réseau Dante. Tu nous détailles un peu le système ?
Matthieu Speck : le réseau TCP/IP est géré par deux switchs Ethernet BSS Audio. Le premier est installé dans le rack de régie et le second dans le rack de scène. Chaque switch dispose de 4 VLAN : un pour le primaire Dante, un pour le secondaire. Le troisième sert de contrôle Ethernet pour la diffusion locale et le dernier est le VLAN d’administration et de communication entre les switchs.

En théorie un seul câble Ethernet suffit à relier les deux mais j’en demande toujours deux, par sécurité. J’ai toujours en plus deux fibres de 250 m dans mon flight case en dépannage ou pour certaines configurations comme aujourd’hui. Le rack de régie contient les deux Mac mini que j’utilise pour diffuser les sons durant le show. J’ai Ableton Live et le Dante Controller sur chacun. Ils sont parfaitement identiques et utilisés en spare. La console Yamaha QL1 orchestre le tout, c’est elle qui est maître du réseau Dante.
Coté scène, j’ai le récepteur de micro HF Shure ULX-D4 qui a l’avantage de sortir directement en Dante et un Lake LM44 qui gère les sorties pour la diff. Il alimente également mon LA4X pour les sides. Pour la diff, on a le choix : analogique ou numérique. La plupart du temps j’ai fourni la sortie en AES.
J’ai mis 10 minutes à tout patcher la première fois !
SLU : Est-ce que c’est compliqué à mettre en place ?
Matthieu Speck : Le routage est simplissime, j’ai une matrice de patch avec les entrées et les sorties, il suffit de cocher les cases pour faire correspondre cette matrice aux entrées-sorties de la QL1. Cela m’a pris 10mn la première fois. Pour l’Espace Cardin, on a ajouté 2 voies de sortie pour les balcons. Le LM44 a été branché en Ethernet sur le switch, et trente secondes après il apparaît sur la matrice ! C’est réellement du plug’n’play.


SLU : Tu apportes également les retours ? Les artistes n’ont pas de ears ?
Matthieu Speck : Oui j’ai deux KIVA sur les côtés, Régis et Philippe ont à peu près tout essayé dans leur carrière pour ce qui est niveau écoute et micro. Aujourd’hui deux Kiva de chaque côté et des micros cravate omni leur conviennent parfaitement.

SLU : Les micros sont omni ! Tu n’as jamais de problème d’accrochage ou de phase ?
Matthieu Speck : Non car toute la chaîne est en 24/48, c’est comme la chaîne du froid, il ne faut pas la rompre si on ne veut pas avoir de soucis. Je n’ai pas eu besoin de faire de correction pour le Larsen.
Pour la phase, c’est inéluctable, lorsque Philippe et Régis sont proches l’un de l’autre, des petits artefacts se créent. Je suis peut-être le seul à les entendre mais ça me gênait.
Christophe Dupin qui m’a accueilli à Dijon, m’a initié à l’Auto-Mixer Dan Dugan, qui est maintenant en série dans les QL et CL. Cette technologie agit comme un gate, ce qui supprime tous mes soucis de phase.
Quand Philippe parle, Régis est automatiquement baissé à -15dB, et inversement. Ça consomme très peu de temps, de l’ordre de 0,2 ms mais c’est intéressant.
SLU : En parlant latence, un système tout numérique comme celui-là induit combien de délai ?

Matthieu Speck : La latence du système Dante est d’une milliseconde. Celle des micros HF est essentiellement liée au système de codage. Shure annonce 2,73 ms, ce qui est largement acceptable surtout pour une telle qualité. Au final on est en dessous de 4 ms, ce qui ne gêne pas les artistes.
SLU : Les micros HF sortent-ils directement en numérique ?
Matthieu Speck : Oui directement en Dante. La conversion se fait dans les émetteurs. Le protocole de transmission radio est un système PSK (Phase Shifting Key) propriétaire de Shure avec correction d’erreurs. Ça permet 120 dB de dynamique en n’occupant qu’une bande de 200 kHz, le tout avec un encodage non compressé et donc aucune perte. Pour moi c’est l’idéal. Le signal est propre sur toute la chaîne et en 24 bits/48 kHz depuis la source jusqu’à la diff.
MOINS on en fait, mieux le son se porte !

SLU : Quelles corrections fais-tu niveau EQ et dynamique ?
Matthieu Speck : Quand je suis accueilli dans une salle, j’essaie de garder tout à zéro. J’aligne les boîtes avec mon logiciel, je vérifie la balance tonale, tout en sachant que je n’ai pas besoin de beaucoup de subs, et j’essaie de ne me servir que du Lake Controller avec parcimonie.
Sur la console, l’EQ se fait sur les mêmes fréquences pour Régis et Philippe vers 530 Hz et vers 1,2 kHz. J’applique aussi un coupe-bas sur les HF à la console, car ils n’en sont pas équipés.

Ils ont des voix très différentes. Philippe ayant parfois une voix un peu nasillarde, j’en enlève un peu dans les médiums, mais cela dépend des jours, de sa forme… Régis a une voix très timbrée et parfois il faut que je corrige pas mal. En début de show, j’ajuste. Plus ça va, moins on fait de balance.
En fonction de leur fatigue, je sais qu’il faut que je joue sur la couleur. Avant qu’ils arrivent je teste le système avec les enregistrements que je connais pour me faire une idée. Je retouche aussi l’égalisation du master, je lâche un peu de bas mid et j’utilise parfois un filtre à plateau dans l’aigu pour ajouter de la brillance quand ça manque.
Je ne compresse pas, je veux garder toute la dynamique, 120 dB sur les micros ! Je garde les doigts sur les fader au cas où Régis aurait l’idée de mettre le micro dans sa bouche auquel cas ça pourrait peut-être clipper (rire !), mais sinon, je préfère garder cette dynamique naturelle.

SLU : Quels check fais-tu en arrivant le matin ?
Matthieu Speck : C’est très simple, j’appuie sur scan. En moins de 30 s c’est synchro sur chaque récepteur, en 1mn30 j’ai tout scanné. Je ne connais pas de liaison qui synchronise aussi vite. Les batteries donnent 11h d’autonomie.
Je refais parfois un check des fréquences le soir, sur le Workbench Shure (qui est installé sur ma tablette avec le Lake) comme ici où je sais qu’il y a un studio télé pas loin, on ne sait jamais. Ensuite je teste la diff, et je suis prêt.
Tout est redondé en analogique…
SLU : Des surprises, des soucis en tournée ?
Matthieu Speck : Aucune, je n’ai absolument jamais eu de problèmes. Ni le Mac, ni le Dante, ni les HF spare ne m’ont servi ! Tout est prévu en analogique en cas de panne Dante. Je demande toujours 8 lignes analogiques : 4 qui me servent d’entrées pour les micros HF, 2 pour les sides, et 2 pour la façade. Tout est systématiquement branché en mode Auto-Select. Mais pour l’instant, je n’en n’ai pas eu besoin.
Conclusion
Matthieu nous avait prévenus, pendant les premières secondes du show, des différences de niveau et de couleur se font effectivement entendre mais sont rapidement corrigées et on retrouve vite une remarquable transparence des voix et une parfaite intelligibilité, même lorsque les deux comiques sont proches l’un de l’autre.
Pas de souffle, on s’y attendait, pas plus que de « pompage » ou d’effets audibles de la part de l’Auto-Mixer. La dynamique enfin est bien là, surtout quand Régis Laspalès envoie ses fameuses répliques plein pot. Les quelques musiques et effets sonores passent aussi très bien malgré la taille plus que raisonnable des Kiva, le petit poucet ligne source tout à fait à sa place dans ce genre de spectacle et pour cette jauge.
Pour finir, et même si l’on considère encore la liaison analogique comme un parachute ventral, les ingénieurs comme Matthieu nous prouvent qu’un système tout numérique trouve sa place en tournée, et montre que la technologie Dante est à la fois aboutie et fiable. La simplicité avec laquelle on ajoute 2 ou 4 voies au système est un atout indéniable et devrait attirer l’attention de bon nombre d’installateurs et d’opérateurs.
Il est donc plus que jamais urgent de se former au réseau et surtout au Dante qui semble avoir convaincu toutes les marques ou presque. Il faudra aussi songer à créer l‘ARAS, l’Administrateur Réseaux Audio et Sécurité pour concevoir des systèmes de diffusion sonore et garantir leur parfaite fiabilité. Le routage audio sur IP est une réalité, ne ratez pas le paquet !
*Age Tendre, la tournée pourrait renaître de ses cendres et connaître son 10e anniversaire. Christophe Dechavanne s’est porté acquéreur du nom et du concept via sa filiale Coyote Live. A suivre…
[/private]